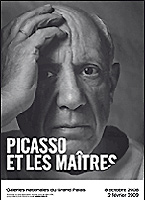Organisée conjointement par la Réunion des Musées Nationaux, le Musée Picasso, le Musée d'Orsay, le Musée du Louvre, la National Gallery de Londres, le Musée du Prado de Madrid et le Musée Picasso de Barcelone, l'exposition "Picasso et les maîtres", qui se tient au Grand Palais, se révèle incontestablement LA grande exposition de l'année 2008.
A l'origine de ce projet grandiose, Anne Baldassari, la directrice du Musée Picasso de Paris, qui en assure le commissariat avec Marie-Laure Bernadac, chargée de l'art contemporain au Louvre, a souhaité proposer un autre regard sur l'œuvre de Picasso en mettant en évidence le dialogue incessant qu'il a eu avec ses maîtres et en le situant dans l'histoire de l'art.
La muséographie a été confiée à Jean-François Bodin qui a été mandaté pour recréer une "grande galerie de peinture idéale à l'architecture invisible pour laisser les oeuvres au premier plan" d'où une scénographie très classique.
Les œuvres de Picasso, présentées sur deux niveaux en sections chrono-thématiques aux côtés de ceux dont elles sont inspirés, sont donc accrochées selon une scénographie peu prégnante constituée de cimaises grisées filigranées de colonnes évoquant notamment celles de la Grande Galerie du Louvre ou du Prado.
Toutefois, une certaine dynamique est introduite par la cimaise oblique au début de l'exposition et par la belle présentation dans la rotonde de la section "La peinture de la peinture" avec ses pans coupés en forme de palais des glaces qui, de gauche à droite, invite le regard à découvrir un fantastique kaléidoscope : "Le grand nu au fauteuil rouge" de Picasso, "Nana" de Manet, "Portrait de femme" du Douanier Rousseau de 1895, "Les amoureux" de Picasso 1919, "La comtesse del Carpio" de Goya et "Madame Moitessier" de Ingres.
 Très
belle scénographie également au deuxième
niveau avec le rétrécissement à la perspective
fuyante consacré aux natures mortes et vanités.
Très
belle scénographie également au deuxième
niveau avec le rétrécissement à la perspective
fuyante consacré aux natures mortes et vanités.
En focale le lumineux "Agnus Dei" de Zurbaran, et
met en relation, les natures mortes quartiers de viande de Chardin,
Picasso et Goya et de l'autre les têtes de mort de Cézanne
et Picasso.
Picasso avec ses pères et ses pairs
L'exposition s'ouvre sur une série d'autoportraits de Picasso réalisés entre 1897 et 1971 qui ouvrent le dialogue avec les maîtres, les classiques français comme les anticlassiques espagnols, et les subversifs tels Cézanne, Van Gogh et Gauguin, et se clôt et se clôt sur l'époustouflante "salle aux grands nus".
 Entre
les deux, dix salles pour dresser le portrait d'un Picasso cannibale
qui assume le meurtre des pères, dixit Marie Laure Bernadac,
pour composer, selon l'expression de Anne Baldassari, des cadavres
exquis selon le procédé de la répétition.
Entre
les deux, dix salles pour dresser le portrait d'un Picasso cannibale
qui assume le meurtre des pères, dixit Marie Laure Bernadac,
pour composer, selon l'expression de Anne Baldassari, des cadavres
exquis selon le procédé de la répétition.
Un procédé palimpsestique qu'il érige en système dans une démarche conceptuelle :pour comprendre le mécanisme de la création picturale.
Chacune de ces variations révèle un monde soutendu par le paradoxe entre l'affirmation du peintre et sa dépendance inéluctable, ou du moins son interdépendance, avec les maîtres du passé mais aussi avec ses contemporains.
Ainsi pastiches, études, modèles, peinture de la peinture, variations et déclinaisons explorent les oeuvres de l'art occidental : Le Gréco ("Garçon conduisant un cheval"), Zurbaran ("Saint Martin et le mendiant"), Ingres ("Eliezer et Rebecca) comme Toulouse-Lautrec ("En cabinet particulier") ou Puvis de Chavannes ("Jeunes filles au bord de la mer".
 Pour
les variations, celles de Delacroix, Manet, Rembrandt sont de
purs moments de bonheur et même si "Les Ménines"
de Velasquez, trésor du Musée du Prado, ne sont
pas venues à Paris, leurs multiples déclinaisons
picassiennes constituent un des sommets de l'exposition avec
les nus des années 60 qui révèlent la quête
obsessionnelle de l'homme vieillissant.
Pour
les variations, celles de Delacroix, Manet, Rembrandt sont de
purs moments de bonheur et même si "Les Ménines"
de Velasquez, trésor du Musée du Prado, ne sont
pas venues à Paris, leurs multiples déclinaisons
picassiennes constituent un des sommets de l'exposition avec
les nus des années 60 qui révèlent la quête
obsessionnelle de l'homme vieillissant.
Cette exposition invite le visiteur à un voyage unique au panthéon de la peinture dans lequel Picasso a sa place à un double titre : comme acteur fondamental du renouveau pictural de la fin du siècle et comme père, à son tour, pour les générations qui le suivent.
Certes, on peut regretter que les salles du premier niveau présentent un amoncellement de toiles de grandes dimensions dans des espaces relativement petits ce qui donnent une impression de saisissement, alors que les toiles plus petites présentées au deuxième niveau aux salles plus amples paraissent un peu noyées.
Cela étant, cette exposition exceptionnelle et magistrale
par son caractère novatoire, le nombre des intervenants,
la densité de chef d'œuvres au mètre carré
et la présence de toiles inédites connaît
un succès phénoménal ce dont il faut bien
évidemment se réjouir. Mais l'affluence rend les
conditions de visite difficiles, voire laborieuses, et implique
de venir dès le matin à l'ouverture.