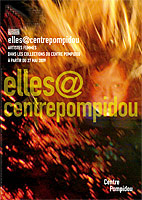Le Musée National d'Art Moderne sis au Centre Pompidou présente un nouvel accrochage thématique des œuvres de ses collections modernes et contemporaines sous le titre "elles@centrepompidou" soit un espace de 8.000 m2 consacrés aux oeuvres des artistes-femmes qui n'ont réellement accédé au monde l'art qu'au 20ème siècle.
Cette initiative muséale fait déjà couler beaucoup d'encre, et ce un peu à tort et à travers, malgré les précisions apportées par la commissaire Camille Morineau, conservatrice audit musée.
En effet, elle insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une exposition au sens classique du terme mais d'une monstration des oeuvres appartenant aux collections du MNAM. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, d'en avoir choisi le mode opératoire qu'elle qualifie de "narration thématique".
Ainsi cet accrochage, qui commence par un clin d'oeil avec l'œuvre de Agnès Thurnauer qui brouille les genres en féminisant le nom des artistes-hommes et masculinisant celui des artistes-femmes ("Portraits grandeur nature"), se déroule selon un parcours chrono-thématique décliné en 7 chapitres reposant sur le paradoxe que l'on retrouve dans tous les arts concernant l'existence d'un art féminin, à savoir l'artiste a-t-il un sexe, qui débouche sur la dimension politique de la représentation.

Accompagnée de cartels explicatifs abondants, la présentation claire et didactique adoptée s'inscrit totalement dans la mission du musée qui est, comme le rappelle Camille Moreau, de "mettre à jour l'histoire et son explicitation".
Le musée au féminin
L'histoire des artistes-femmes commence au niveau 5 avec le chapitre des "Modernes" qui atteste de la présence des artistes-femmes, pendant la première moitié du 20ème siècle, dans toutes les disciplines et toutes les avant-gardes : Germaine Richier, Sonia Delaunay, Frida Kahlo, Claude Cahun et Charlotte Perriand, pour ne citer que les plus emblématiques.

Le visiteur pourra apprécier la belle salle consacrée aux "Réflexives" avec, entre autres, les peintres Marie Laurencin, Maria Blanchard, Suzanne Valadon et Nathalie S. Gontcharova.
 De
même pour la salle des "Abstraites" (de gauche
à droite Joan Mitchell, Shirley Jaffe et Helen Frankentaler).
De
même pour la salle des "Abstraites" (de gauche
à droite Joan Mitchell, Shirley Jaffe et Helen Frankentaler).
Au niveau 4, la seconde moitié du 20ème siècle se décline en 6 périodes qui commencent avec les années 60 placées sous le signe des femmes artistes, actrices et témoins de l'Histoire, qui s'engagent dans la cause féministe.
C'est "Feu à volonté" inspiré par les tirs de Niki Saint Phalle soeur aînée des Guerilla Girls newyorkaises.
 A
éviter pour les prudes, la salle "Génital
Panic" avec, notamment, les oeuvres de Elke Krystufek,
Evelyn Axell et Betty Tompkins où le corps sexué
sans ambiguité est representé comme moyen de revendication
et de réappropriation du corps.
A
éviter pour les prudes, la salle "Génital
Panic" avec, notamment, les oeuvres de Elke Krystufek,
Evelyn Axell et Betty Tompkins où le corps sexué
sans ambiguité est representé comme moyen de revendication
et de réappropriation du corps.
Pour certaines, le corps devient le lieu du discours, comme pour Orlan, objet-sujet de performance avec Sirgit Landau, et pour d'autres, telles Gina Pane et Sophie Calle, l'art est un moyen de narration autobiographique ou autofictionnelle.

Autre aspect avec "Face à l'histoire" où l'on retrouve Annette Messager et Eva Aeppli.
 Le
panorama est large et il ne faut pas rater la double salle dédiée
à "Extrême tension" du chapitre "Eccentric
abstraction" où les artistes-femmes, dont Eva
Hesse, Silvia Bäclhi,
Yayoi Kusama et Lee
Bontecou, prospectent de nouvellles voies à partir
de stratégies inexplorées.
Le
panorama est large et il ne faut pas rater la double salle dédiée
à "Extrême tension" du chapitre "Eccentric
abstraction" où les artistes-femmes, dont Eva
Hesse, Silvia Bäclhi,
Yayoi Kusama et Lee
Bontecou, prospectent de nouvellles voies à partir
de stratégies inexplorées.
En collaboration avec l'INA, le Centre Pompidou a mis en ligne un site très documenté qui permet, notamment grâce à un plan interactif et à une fresque chronologique, de préparer utilisement la visite.
Par ailleurs, cet accrochage, programmé pour une année avec la présentation de nouvelles oeuvres en janvier 2010, s'accompagne de très nombreux évenements collatéraux conférences, lectures et films.