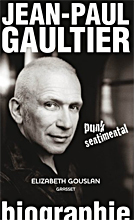Jean-Paul Gaultier a fêté en 2007 le trentième anniversaire de sa marque. Le fameux "enfant terrible de la mode", le rescapé des modes, le survivant du trio des années 80, qu'il constituait avec Thierry Mugler et Claude Montana, comme des stylistes de la même époque qui se sont dégonflés comme des baudruches.
Il est devenu, à la mesure de l'aune du troisième millénaire qu'est le jeunisme, presque un ancêtre, même si bientôt il n'aura plus de besoin de se péroxyder et que son intégration dans l'écurie prêt-à-porter de la maison Hermès, qui n'est pas réputée pour être le chantre de l'avant-gardisme, conserve intact non seulement son talent créatif mais son capital de sympathie.
Elizabeth Gouslan lui consacre une biographie sous le titre "Jean-Paul Gaultier - Punk sentimental" qui s'avère simultanément un peu plus et un peu moins qu'une biographie.
Ne prétendant pas à l'œuvre d'historien de la mode, de sociologue ou de politologue, elle aborde de manière circonstancielle la vie de l'homme et le parcours du couturier en évitant deux écueils récurrents de ce type d'exercice que sont le déballage des poubelles et la psychologie de bazar.
Certains en seront donc pour leur frais car pas de ragots ni de dérives croustillantes. Pour les autres, notamment ceux de la génération du couturier, ce sera une roborative lecture "madeleine" car Elizabeth Gouslan a pris le parti d'esquisser le portrait d'un créateur complètement immergé dans son siècle et qui, en l'occurrence s'agissant de l'art éphémère et inconstant qu'est la mode, se décompte en saisons. Ce qui l'amène à brosser l'évolution du microcosme parisien sur les trois décennies de fin de millénaire.
Elle écrit que chroniquer une collection de "Tintin au pays des frou-frou", dont le talent consiste en un flair visionnaire pour "copier-coller-sauvegarder l'air du temps" et qui a pour totem le corset aux bonnets coniques, résurgence fantasmatique des dessous de sa Mémé Garrabé, suppose "une bonne érudition, un vrai coup de crayon et une plume leste".
Qualités dont elle fait preuve. Journaliste et chroniqueuse, elle a la plume déliée, le sens de la formule et du raccourci qui fait mouche - ses portraits en une ligne sont irrésistibles ainsi par exemple Christian Lacroix "dandy arlésien qui instaure un folklore chic pour opérettes glamour" -, l'art de la synthèse, certes parfois un peu réductrice ou radicale, et de l'humour. Ce qui ajoute grandement au plaisir de la lecture de cette fresque sociétale même pour ceux qui ne sont pas des fashion victimes.
Celle-ci commence par les débuts laborieux du jeune Gaultier dans les années 70 face au "sérail policé prout-prout de la mode" jalousement gardé par les couturiers dinosaures.
Dans un premier temps, il "adoube la punkitude et affiche des goûts de concierge". Son premier défilé en 1974 sous la coupole du Palais de la Découverte avec des vêtements bricolés tient, écrit-elle, "du spectacle de patronage, des travaux pratiques, du travail manuel maternelle moyenne section. C'est un work in progress, happening de cancre doué, un ready made dadaiste pour cours de récréation".
Pendant les années Giscard, en appliquant le story-telling au défilé, il désacralise son rituel comme les sociétés de l'époque désacralise tout. Dans les années Palace, les années de la sape et du Palace qui célèbre "une humanité fêtarde qui a un pois chiche à la place du cerveau et une démarche d'albatros pailleté", il saisit immédiatement l'émergence du "multilook" et obtient l'indispensable sésame médiatique en devenant le chouchou des rédactrices de mode séduites par "le mélange de spontanéité banlieusarde et d'ironie bienveillante" qu'il dégage.
En Mitterandie, pendant que "la haute couture joue sa petite musique de chambre", avec sa science de la "walk street", le lancement du casting sauvage pour recruter ses mannequins et la transcendance de l'iconographie gay, il devient le rock star de la mode qui se veut spectacle et est un des mousquetaires, avec Philippe Starck, Pascal Mondino et Jean-Paul Goude du bicentenaire de la Révolution française.
Les années "frime et fric" du troisième millénaire, ère du "beautiful people", ne désarçonnent pas Gaultier, "le papier carbone des tendances" toujours bien encré et ancré dans son temps. A voir son parfum dans un flacon en forme de sex toy représentant une "Barbie décapitée". Celui qui est entré dans son second demi-siècle n'a plus rien à prouver. Il a accédé à la marche suprême de la haute couture en 1997, même si son rêve d'habiter Diorville ne s'est pas réalisé, coiffé au poteau par le pirate trash, "le torero de la coupe" John Galliano, en créant sa propre maison.
Elizabeth Gouslan met également l'accent sur les deux femmes qui ont marqué son travail. Madonna, bien sûr. Gaultier fasciné par Madonna, seule femme qui le domine et à laquelle il obéit comme un laquais, fasciné par son génie qui consiste à surfer sur "le scandale et le désir, vecteurs efficaces de l'idolatrerie" dont il fera le thème de son défilé "Religieuses".
Et Régine Chopinot, danseuse et chorégraphe, une sorte d'alter ego, avec laquelle il va peaufiner sa grammaire esthétique qui a été encensée par l'exposition "Défilé" au Musée des arts décoratifs où "la modernité de ses créations [était] encensé jusqu'à l'embaumement".
Ainsi en trente chapitres chronothématiques qui suscitent flash back et focus et dynamisent la lecture, Elizabeth Gouslan épingle la mode, décrypte la patte Gaultier et brosse de manière impressionniste, en croisant les points de vue, le portrait-arlequin d'un couturier aux mille vies qui dans l'intimité est un homme plutôt sage et rangé, vivant et travaillant avec un noyau dur insubmersible de fidèles.
Et en 2010, avec son ring de boxe pour le défilé de sa collection homme, il est toujours dans le coup et ne semble pas prêt à raccrocher les gants au vestiaire.